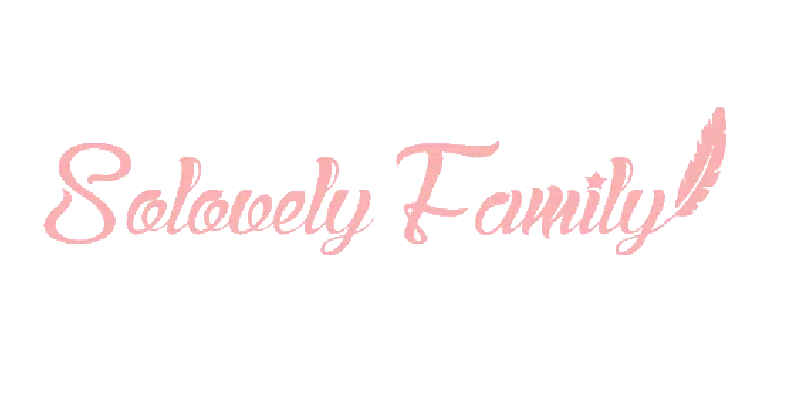L’usage du landau était autrefois strictement réservé à une certaine élite, tandis que la majorité des familles improvisaient des solutions de transport pour les nourrissons. Les réglementations sanitaires du début du XXe siècle imposaient parfois des normes contradictoires, interdisant certains matériaux jugés inadaptés, tout en tolérant des pratiques aujourd’hui considérées comme dangereuses.
L’écart entre les modèles de poussettes selon le milieu social, l’accès aux soins et les convictions éducatives alimentait des débats persistants autour du bien-être des enfants. Ces pratiques, loin d’être uniformes, révélaient déjà les tensions autour des rôles parentaux et de la prévention en matière de santé mentale périnatale.
À quoi ressemblaient les premières poussettes et pourquoi ont-elles tant changé ?
La poussette d’antan n’avait rien du confort actuel. En 1733, William Kent imagine pour le duc de Devonshire un engin surprenant : une sorte de panier monté sur trois roues, tiré par un animal de compagnie. Le privilège était réservé à la haute société, loin de la réalité des familles ordinaires. Il faut attendre 1848 pour voir Charles Burton déposer le brevet d’un modèle à poignées qui, pour la première fois, permet à l’adulte de pousser l’enfant devant soi. Ce simple changement de direction du geste parental redéfinit la relation adulte-enfant.
Le landau, directement inspiré des carrosses et du vocabulaire hippomobile, fait son entrée au XIXe siècle. Sa nacelle spacieuse, qui tient son nom de la ville allemande Landau in der Pfalz, accompagne le nourrisson durant ses premiers mois. La manufacture anglaise Silver Cross, adoubée par la famille royale britannique, en fait un objet de distinction : grandes roues, capote imposante, ressorts pour amortir les secousses… chaque détail célèbre le confort et le statut social.
À partir des années 1920, la production de masse bouleverse la donne. Le landau perd du terrain, la poussette gagne en légèreté et s’adapte à la ville, répondant au besoin de mobilité. Dans les années 1970, la poussette s’impose définitivement, enrichie d’accessoires comme le sac à langer, l’habillage pluie ou la planche à roulettes. Ces évolutions racontent bien plus que la technique : elles disent la transformation du quotidien, la montée de la praticité et la reconnaissance de l’enfant comme acteur de l’espace public.
Petite histoire des pratiques parentales : entre traditions et innovations
Avant l’arrivée de la poussette, le portage demeurait la règle. Mères, pères, nourrices transportaient l’enfant contre eux, à l’aide de simples étoffes. Cette méthode, universelle, répondait à trois besoins fondamentaux : proximité, sécurité et mobilité. L’enfant suivait le rythme de l’adulte, adaptant son sommeil et son éveil aux mouvements des champs ou des ruelles.
À partir du XVIIIe siècle, la donne change en Occident : le portage passe en retrait, la domesticité s’affirme, les rôles parentaux se spécialisent. Cette pratique, jugée archaïque, ne disparaît pas complètement : elle survit en filigrane, avant de refaire surface dans les années 1970. La méthode Kangourou, née à Bogotá en 1979, montre ses vertus pour les bébés prématurés : mortalité réduite, meilleure stabilité, diminution des infections. Les arguments scientifiques redonnent au portage ses lettres de noblesse.
L’écharpe de portage, réinventée en Allemagne par Erika Hoffman, s’inspire d’un savoir-faire mexicain. La marque Didymos publie les premiers guides modernes, ouvrant la voie à une nouvelle hybridation des pratiques. Les familles urbaines redécouvrent cette tradition, oscillant entre recherche d’authenticité et modernité. Parallèlement, la poussette se dote d’accessoires : capote, habillage pluie, planche à roulettes, sac à langer. Autant de signes d’une parentalité qui conjugue mobilité, confort et adaptabilité, sans rien sacrifier à la relation parent-enfant.
Prévention en psypérinatalité : ce que l’histoire des poussettes nous apprend sur le bien-être familial
Le bien-être familial se façonne aussi dans l’ombre discrète des objets du quotidien. Poussette, landau, portage : derrière ces équipements, chaque époque réinvente le lien entre adulte et enfant, influant sur la santé mentale des familles. L’essor de la psypérinatalité invite aujourd’hui à relire ces évolutions à la lumière des connaissances sur l’attachement et le développement du tout-petit.
Jusqu’au XVIIIe siècle, le portage favorise une proximité affective immédiate. Dans les années 1970, la méthode Kangourou en Colombie en démontre les bénéfices : baisse de la mortalité, meilleure stabilité physiologique, apaisement des parents. Les travaux scientifiques l’attestent : cette proximité corporelle facilite l’autorégulation émotionnelle du bébé, mais aussi celle de l’adulte.
L’apparition de la poussette, dès 1733 avec William Kent, redistribue les équilibres. Le bébé observe le monde, l’adulte retrouve une mobilité et une autonomie nouvelles. L’arrivée d’accessoires comme la capote, la protection pluie ou l’assise ergonomique accompagne cette transformation, toujours en quête d’équilibre entre besoins de l’enfant et contraintes du quotidien.
Aujourd’hui, la prévention en psypérinatalité incite à conjuguer autonomie, sécurité physique et soutien psychique. Explorer l’histoire de la poussette, c’est relier ergonomie et traditions anciennes, tout en questionnant nos attentes contemporaines. Cette transmission, ce questionnement sur le sens des gestes, nourrissent le lien familial et, par ricochet, la santé globale de la famille.
Enjeux de genre et parentalité : quand la poussette devient révélatrice de nos sociétés
Dès la fin du XIXe siècle, la poussette s’impose comme signe de modernité, mais aussi de répartition des rôles parentaux. La reine Victoria contribue à sa popularité, bouleversant la vie des familles urbaines, et tout particulièrement celle des femmes. Le portage, traditionnellement confié aux nourrices ou aux mères, cède progressivement sa place à un objet technique associant progrès et distinction sociale.
L’industrialisation à partir des années 1920 démocratise la puériculture. Promener son enfant en poussette devient un rituel, exposant mère et enfant au regard public. Pourtant, l’objet n’est pas neutre : il reproduit des enjeux de genre persistants. Jusqu’aux années 1970, la poussette reste l’affaire des femmes, comme en témoignent publicités et usages quotidiens. Le père s’installe derrière la poussette bien plus tard, porté par le changement des mentalités et l’émergence de nouveaux modèles familiaux.
L’histoire de la poussette met en lumière la lente redistribution des tâches parentales. Elle cristallise, décennie après décennie, les tensions entre tradition et modernité, la division sexuée du travail domestique, mais aussi la volonté de partager l’expérience de la parentalité. L’arrivée de modèles multifonctions, compacts, témoigne d’une adaptation constante aux attentes d’égalité et de mobilité. Derrière son apparente banalité, la poussette raconte, mieux que bien des discours, la transformation de la famille et la société qui l’entoure.