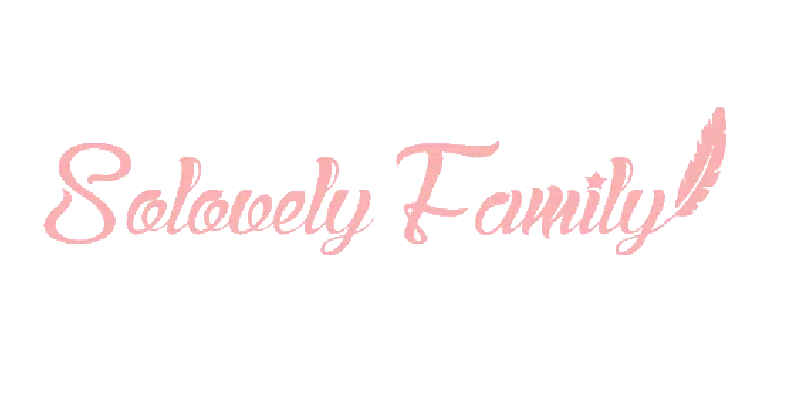La version la plus diffusée de Cendrillon diffère radicalement de celle consignée par Charles Perrault ou les frères Grimm. Les éditeurs du XIXe siècle ont systématiquement modifié certains passages jugés inacceptables pour le jeune public. Les premières variantes européennes du conte comportaient des éléments aujourd’hui absents, issus de traditions orales et de croyances locales. Ces suppressions et adaptations ont façonné la perception collective du dénouement, tout en voilant certains aspects fondamentaux du récit.
Pourquoi la véritable fin de Cendrillon intrigue-t-elle autant ?
Parler de la véritable fin de Cendrillon, c’est ouvrir la porte à des contrastes saisissants et à des zones d’ombre rarement explorées. Là où Charles Perrault choisit la voie de la douceur, les frères Grimm assument une brutalité qui détonne. La pantoufle de verre, plus qu’un simple accessoire, devient l’outil d’une reconnaissance sociale éclatante, mais aussi le déclencheur d’une transformation sans retour, pour le meilleur comme pour le pire.
Dans la version des Grimm, l’histoire prend un virage glaçant : les demi-sœurs, prêtes à tout pour séduire le prince, vont jusqu’à se mutiler les pieds. Leur échec se solde par une punition sans appel : des oiseaux leur crèvent les yeux lors du mariage de Cendrillon. Rien à voir avec la version Charles Perrault, où la famille finit par se réconcilier dans un élan de pardon collectif.
Ce choix narratif n’est pas anodin. Il traduit une volonté d’offrir un message tranchant : la vertu s’atteint à travers l’épreuve, la duplicité se paie par l’exclusion. Derrière l’apparence d’un conte pour enfants, le texte interroge la place de la jeune fille dans la société et sa légitimité à obtenir justice. Les adaptations modernes, Disney en tête, préfèrent occulter cette noirceur pour mettre en avant une héroïne victorieuse, plus conforme aux attentes du public d’aujourd’hui.
Pour mieux cerner les nuances entre les versions, voici ce qui les distingue :
- Chez les Grimm, la violence et la justice sans compromis dominent le récit.
- Perrault mise sur la réussite sociale et la clémence, évacuant la dimension punitive.
- La pantoufle de verre incarne à la fois l’ascension et l’exclusion, selon la version retenue.
Ce basculement n’est pas anodin : il révèle toute la complexité d’un conte qui va bien au-delà du simple triomphe de la gentillesse. C’est un miroir tendu à nos propres contradictions, entre besoin de merveilleux et fascination pour la justice implacable.
Des versions méconnues aux révélations surprenantes du conte
Bien avant que Disney ne s’en empare, Cendrillon a voyagé de culture en culture, s’enrichissant de variantes souvent ignorées. Dès le XVIIe siècle, Giambattista Basile propose dans le Pentamerone une héroïne nommée Zezolla, marquée par l’ambiguïté : sa marraine-fée n’est pas toujours l’alliée rassurante qu’on imagine, la magie s’entrelace à des jeux de pouvoir familiaux où la rivalité est reine.
Ce n’est qu’un début. La spécialiste suédoise Anna Birgitta Rooth a recensé plus de 700 variantes du cycle de Cendrillon à travers le monde. Parmi elles, la version chinoise de Ye Xian, antérieure à Perrault, met en scène une héroïne guidée non par une marraine-fée, mais par l’esprit d’un poisson magique. L’épreuve imposée par la belle-mère y prend une dimension métaphorique, soulignant la force de la ruse et du courage.
Ces variantes se distinguent par plusieurs aspects marquants :
- Basile met en scène Zezolla, une figure à la fois victime et stratège, loin de la passivité attendue.
- Selon les cultures, la marraine-fée change de visage, voire disparaît complètement.
- Le motif de la chaussure traverse les frontières, se transformant en sandale brodée, soulier d’or ou pantoufle de verre.
Ce foisonnement montre à quel point le conte est malléable. D’une société à l’autre, Cendrillon incarne l’ascension, la transgression ou la résistance, selon ce que chacun veut bien y projeter.
Un secret bien gardé : ce que les adaptations modernes ne montrent pas
La véritable fin de Cendrillon a été soigneusement écartée des versions les plus populaires. En 1950, Disney impose une vision lumineuse : la jeune fille persécutée trouve enfin la paix, la marâtre s’efface, l’happy end s’installe. Pourtant, en se penchant sur les textes fondateurs, on découvre une réalité bien plus âpre. Les frères Grimm, notamment, ne reculent pas devant la cruauté : les demi-sœurs, prêtes à tout pour séduire le prince, en viennent à mutiler leurs propres pieds, avant d’être punies par la cécité lors du mariage royal.
Les œuvres récentes, qu’il s’agisse du film de Kenneth Branagh ou du long-métrage A tout jamais, une histoire de Cendrillon avec Drew Barrymore, préfèrent s’attarder sur l’émancipation féminine et la quête de justice. La brutalité originelle disparaît au profit d’une héroïne moderne, active et déterminée. Sur scène, Joël Pommerat revisite la légende en donnant à la marraine-fée un visage moins rassurant, parfois manipulateur, loin des stéréotypes édulcorés des dessins animés.
Trois éléments clés illustrent ce que les versions actuelles laissent de côté :
- La punition des sœurs passe à la trappe, remplacée par une simple absence ou une réconciliation rapide.
- Le château de Hautefort sert de décor féérique, mais fait oublier la tension dramatique sous-jacente.
- La chaussure, jadis symbole de sacrifice, devient un simple objet magique.
Ce que les films et adaptations omettent, c’est l’amertume originelle du conte : la victoire de Cendrillon n’est pas sans prix, et le chemin vers le bonheur n’est jamais dénué d’obstacles.
Ce que la vraie conclusion de Cendrillon dit de notre rapport aux contes
La fin véritable de Cendrillon remet en cause l’image d’une jeune fille passive, récompensée par hasard ou par magie. Les textes de Perrault et des frères Grimm exposent une autre réalité : la justice s’exerce sans détour, et la famille doit assumer ses fautes. Cette différence de ton met en évidence une tension persistante chez le lecteur d’aujourd’hui, partagé entre le désir d’un univers enchanteur et la nécessité d’affronter le réel.
La violence symbolique, mutilations, bannissements, châtiments, soulève la question du rôle de la cruauté dans les récits pour enfants. Pourquoi transmettre de telles histoires dès le plus jeune âge ? Parce que le conte, par nature, encode les inquiétudes, les conflits, et offre une forme de rédemption. Si les adaptations modernes préfèrent gommer ces aspects, c’est qu’elles cherchent à rassurer, mais aussi à simplifier le rôle des femmes et des jeunes filles dans la fiction.
Voici ce qui change dans la représentation contemporaine :
- La jeune femme n’est plus spectatrice de sa destinée : elle prend les rênes, fait des choix, assume ses décisions.
- Le conte perd peu à peu sa fonction cathartique pour devenir un miroir d’identification positive.
En effaçant la cruauté des récits populaires, la société gagne en bienveillance mais perd une part de la complexité initiatique. Sous la surface des happy ends, subsistent les échos d’une histoire qui apprend à grandir, à affronter la perte et à se forger sans attendre de miracle. Cendrillon, en silence, nous rappelle que la lumière ne s’apprécie jamais autant qu’après l’ombre.